En 2025, 81 % des salariés déclarent ressentir une fatigue mentale liée aux exigences et aux pressions de leur travail, et près d’un salarié sur deux (45 %) se trouve en détresse psychologique modérée ou élevée. Aussi, 1 salarié sur 10 est en burn-out sévère.
Si le burn-out constitue un véritable trouble reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé, il reste encore tabou dans de nombreuses entreprises. Beaucoup de collaborateurs hésitent encore à parler de leur épuisement, par peur d’être jugés, incompris, voire fragilisés dans leur parcours professionnel.
Pourtant, oser en parler à son employeur est un acte de lucidité et de protection. C’est une démarche essentielle pour prendre soin de soi, obtenir un soutien adapté et éviter que l’épuisement ne s’installe durablement. C’est aussi une responsabilité partagée : la qualité du dialogue autour de la santé mentale au travail conditionne directement le climat social, l’efficacité collective et la performance de l’organisation.
Découvrez comment reconnaître les signes précurseurs, préparer sa prise de parole et trouver les bons mots pour aborder son burn-out avec son employeur.
Reconnaître les signes avant d’agir
Beaucoup de collaborateurs tardent à alerter leur hiérarchie, pensant que la fatigue finira par passer ou que leurs difficultés relèvent d’un manque de résilience personnelle. Pourtant, savoir reconnaître les signaux d’alerte permet d’agir plus tôt et d’éviter un épuisement durable.
L’Organisation mondiale de la Santé décrit le burn-out comme un syndrome lié au stress chronique au travail, qui n’a pas été géré avec succès. Trois dimensions principales le caractérisent :
- Un épuisement intense, aussi bien physique que psychique, qui rend difficile la récupération même après le repos
- Un sentiment de détachement, de cynisme ou de négativité vis-à-vis de son travail, comme si toute motivation s’était éteinte
- Une diminution de l’efficacité professionnelle, avec la sensation de ne plus être capable de répondre aux attentes ni d’atteindre les objectifs fixés.
Ces trois critères, lorsqu’ils se cumulent, signalent que l’on n’est plus face à une simple fatigue, mais bien à un état d’épuisement professionnel.
En pratique, le burn-out peut se traduire par :
- Une fatigue persistante, même après plusieurs nuits de repos
- Des troubles du sommeil, une irritabilité ou une anxiété accrue
- Des difficultés de concentration et de mémoire
- Des douleurs somatiques (maux de dos, migraines ou encore troubles digestifs)
- Une perte d’intérêt pour ses missions ou une impression de tourner en rond
Le saviez-vous ? 7 salariés sur 10 en détresse psychologique estiment que ce mal-être est directement lié à leur activité professionnelle.
Burn-out, mais aussi brown-out et bore-out
Il est aussi important de distinguer le burn-out d’autres formes de mal-être professionnel :
- Le brown-out : perte de sens dans son travail, souvent liée à des missions perçues comme absurdes ou déconnectées des valeurs personnelles.
Ces situations, bien que différentes, entraînent des répercussions similaires : baisse d’énergie, perte d’engagement et risque accru de détresse psychologique.
À lire aussi : tout savoir sur le surmenage au travail.
Les enjeux de parler de son burn-out à son employeur
Lorsqu’un salarié traverse un burn-out, la tentation de se taire est forte. Beaucoup préfèrent continuer à avancer coûte que coûte, par peur d’être jugés faibles ou de fragiliser leur carrière. Pourtant, garder le silence peut aggraver la situation, tant sur le plan personnel que professionnel.
Le premier enjeu est évident : préserver sa santé mentale et physique. Le burn-out n’est pas une « mauvaise passe » que l’on peut régler seul avec un peu de repos. C’est un syndrome reconnu qui, sans accompagnement adapté, peut mener à une dépression sévère, à des troubles chroniques ou à un désengagement durable.
En parler à son employeur permet aussi d’envisager des solutions concrètes : allègement temporaire de la charge, aménagement du poste, télétravail, voire arrêt maladie si nécessaire. Les entreprises ont, par ailleurs, une obligation légale de protéger la santé de leurs salariés (Code du travail, art. L.4121-1). Ne rien dire revient donc à se priver de droits et de protections auxquels on peut légitimement prétendre.
Exprimer ses difficultés n’est pas seulement un moyen de se protéger dans l’immédiat. C’est aussi un acte de prévention. Un dialogue ouvert permet d’identifier les causes du burn-out (surcharge, manque de clarté des missions, conflits internes…) et d’éviter que la situation ne se reproduise.
BParler de son burn-out contribue également à faire tomber le tabou de la santé mentale en entreprise. Chaque témoignage individuel alimente une culture de prévention collective, incitant les organisations à prendre le sujet au sérieux.
Entre peur du jugement et nécessité de se protéger
Si parler de son burn-out à son employeur est une étape essentielle, elle reste pour beaucoup un véritable défi. La santé mentale demeure un sujet tabou dans de nombreuses organisations, et les collaborateurs redoutent les conséquences d’une telle confession.
Nombreux sont ceux qui craignent d’être perçus comme fragiles, peu fiables ou incapables de gérer la pression. Cette appréhension est renforcée par des cultures d’entreprise où la performance prime sur l’humain.
59 % des salariés se disent stressés au quotidien et beaucoup estiment que leur hiérarchie valorise davantage la productivité que la santé psychologique.
Un autre frein fréquent est la crainte d’un impact négatif sur son avenir professionnel : être écarté de projets, perdre une opportunité d’évolution, voire être licencié. Pourtant, la loi protège les salariés contre toute discrimination liée à l’état de santé, y compris psychologique. Un employeur ne peut sanctionner ou congédier une personne en raison de son burn-out.
Certains collaborateurs redoutent que leur parole soit minimisée ou banalisée : « Ce n’est qu’un coup de fatigue », « Tu exagères ». Le défi consiste donc à dépasser la peur du jugement pour affirmer une nécessité, celle protéger sa santé et faire valoir son droit à des conditions de travail respectueuses de l’équilibre psychologique.
Préparer sa prise de parole en amont
Parler de son burn-out à son employeur ne s’improvise pas. Cette discussion délicate peut être source d’anxiété si elle est abordée dans la précipitation. Une bonne préparation en amont permet de structurer son discours, de clarifier ses besoins et d’augmenter ses chances d’être entendu.
La première question à se poser est simple : à qui en parler ? Dans la plupart des cas, le manager direct constitue le premier interlocuteur, puisqu’il connaît le quotidien du collaborateur et peut agir concrètement sur l’organisation du travail.
Mais il est également possible de se tourner vers les ressources humaines, qui jouent un rôle clé pour officialiser la démarche, envisager des aménagements structurels ou orienter vers un arrêt de travail si nécessaire.
Enfin, le médecin du travail reste un allié essentiel : tenu par le secret médical, il peut attester de la situation et recommander des ajustements adaptés.
Avant l’entretien, il est important de mettre des mots précis sur ce que l’on ressent. Cela peut passer par :
- Noter ses symptômes (fatigue, troubles du sommeil, anxiété, perte de concentration, etc.)
- Identifier les facteurs aggravants (surcharge de travail, manque de clarté des missions, ou encore conflits non résolus)
- Définir ses besoins immédiats : temps de repos, aménagement de poste, soutien psychologique ou encore réduction temporaire de la charge
Choisir le bon moment et le bon canal
Choisir le moment et le canal pour aborder son burn-out avec son employeur est essentiel. L’idéal est d’éviter les périodes de forte tension, comme la clôture d’un projet, afin de bénéficier d’une écoute plus disponible. Mais il ne faut pas non plus attendre trop longtemps : lorsque la santé est en jeu, la priorité reste d’en parler, même dans un contexte moins favorable.
Le cadre de l’échange a lui aussi son importance. Un rendez-vous planifié, en tête-à-tête ou en visioconférence, est préférable à une discussion improvisée dans un couloir.
Enfin, si le face-à-face reste la meilleure option, un message écrit peut servir à préparer le terrain et demander un entretien, permettant ainsi d’éviter l’effet de surprise.
Rester factuel tout en exprimant ses limites
Lorsqu’on évoque un burn-out à son employeur, il est important d’adopter un ton à la fois clair et mesuré. L’objectif n’est pas de dramatiser la situation ni de la minimiser, mais d’exposer des faits concrets.
Plutôt que de parler de « ras-le-bol » ou de « craquage », il est préférable d’utiliser des formulations claires et concrètes : « Je ressens une fatigue intense qui ne disparaît pas malgré le repos », « J’ai de plus en plus de mal à me concentrer et cela affecte la qualité de mon travail », ou encore « Je n’arrive plus à gérer la charge qui m’est confiée sans mettre ma santé en danger ». Ces phrases permettent de décrire la réalité sans dramatiser ni culpabiliser. Elles ouvrent la voie à un dialogue constructif, où l’on peut ensuite préciser ses besoins : « J’aurais besoin d’un aménagement temporaire de ma charge de travail » ou « Je pense qu’un arrêt serait nécessaire pour me rétablir ».
Le rôle de l’employeur face à un signal d’alerte
Quand un collaborateur exprime un burn-out, l’employeur joue un rôle clé : écouter sans jugement, prendre la parole au sérieux et agir rapidement. On le rappelle : la loi impose à l’entreprise de protéger la santé mentale et physique de ses salariés.
Concrètement, cela peut passer par un aménagement de la charge de travail, une mise en place de temps de repos, ou un accompagnement via le médecin du travail et les RH. Le manager doit aussi assurer un suivi régulier, afin de prévenir la rechute et montrer que la parole du salarié a été entendue et respectée.
Découvrez également comment prévenir le burn-out et comment aider une personne en burn-out.
Et si l’écoute n’est pas au rendez-vous ?
Il arrive malheureusement que la parole d’un salarié en burn-out ne soit pas accueillie comme elle le devrait : minimisation des symptômes, absence de mesures concrètes, voire suspicion d’exagération.
Dans ce cas, il est important de ne pas rester isolé. Le recours au médecin du travail constitue une première étape : il peut évaluer la situation, recommander des aménagements et proposer un arrêt si nécessaire.
Si le dialogue reste bloqué, un représentant du personnel, un médiateur ou un accompagnement externe (psychologue, plateforme de soutien) peuvent intervenir. Le salarié peut aussi, en dernier recours, s’appuyer sur ses droits légaux pour protéger sa santé.
Après avoir parlé : rebondir sans pression
Le burn-out nécessite souvent un temps de repos médicalement encadré, qui permet de couper avec la charge mentale accumulée. La reprise ne doit pas être brutale : un retour progressif, des missions adaptées ou un aménagement du temps de travail facilitent la transition. Le soutien d’un psychologue peut également aider à retrouver confiance et équilibre.
Côté employeur, l’accompagnement est essentiel : écoute régulière, suivi de l’évolution et ajustements organisationnels évitent la rechute.
Rebondir après un burn-out n’est pas revenir comme avant, mais avancer autrement, avec des repères plus sains et durables.
En parler, c’est aussi participer à la prévention
Parler de son burn-out ne bénéficie pas seulement au salarié concerné : cela contribue aussi à une démarche de prévention collective. Chaque témoignage met en lumière des dysfonctionnements organisationnels (surcharge, manque de clarté des missions, management inadapté, etc.) qui peuvent concerner d’autres collaborateurs. En osant s’exprimer, le salarié ouvre la voie à une prise de conscience et incite l’entreprise à renforcer ses politiques de santé mentale.
Lever le tabou favorise donc une culture d’entreprise plus saine, où chacun se sent autorisé à parler de ses difficultés, réduisant ainsi les risques psychosociaux et renforçant la performance collective.
Pour accompagner ces démarches, la solution de bien-être au travail teale propose un soutien complet : programmes personnalisés, accès confidentiel à des psychologues et coachs, ainsi qu’un suivi collectif pour aider les organisations à prévenir l’épuisement.
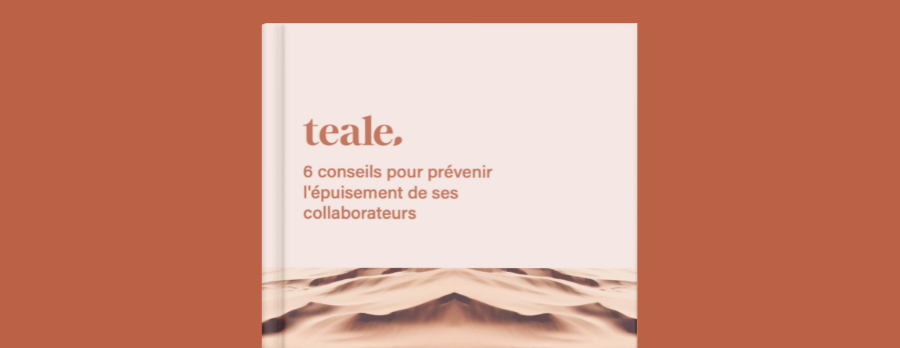


.avif)

